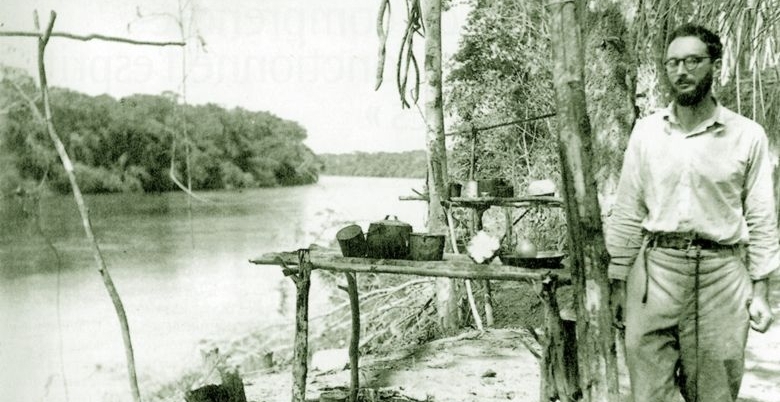Johannes Fabian a montré, dés le début des années 80, que le discours de l’anthropologie était généralement « allochronique », c’est à dire basé sur le déni d’un temps intersubjectif, ou encore, plus simplement, sur un déni de la communication qui ne peut pourtant manquer de se nouer entre l’anthropologue et ceux qu’il observe. Cette idée est fondatrice d’une autre façon de pratiquer l’anthropologie. Ses implications sont évidemment méthodologiques, mais aussi politiques dans la mesure où reconnaître qu’une communication peut se produire entre l’observateur et l’observé équivaut à rompre une relation asymétrique qui voit généralement le premier (l’observateur) établir une supériorité par rapport au second, presque à son insu, par le simple fait de le constituer en objet scientifique.
Il semble pertinent de prolonger ce débat théorique en le passant au crible de la philosophie du langage ordinaire américaine au travers de trois philosophes : Wittgenstein, Austin et Cavell. Pour ce faire, nous nous réfèrerons à une situation ordinaire, une jeune mère qui parle à son enfant en public. L’analyse interactionnelle de cette scène, engagée à partir d’indices observables, tend à montrer que cette jeune femme est en train de produire une communication élaborée, référée à plusieurs niveaux d’interlocuteurs : un interlocuteur superficiel (son enfant) ; des interlocuteurs implicites (les parents qui passent). Mais cette stratégie discursive semble aussi détournée d’une finalité qui elle même semble indistincte. Cette situation permet de considérer, avec Austin, le langage comme un lieu d’accord ou un lieu de rupture, ou encore le mode permettant de s’entendre sur cette façon une de décrire et de comprendre le monde. Si l’on revient à l’exemple choisi, cette jeune femme semble entrevoir que le langage tend vers la possibilité de sa rupture, la possibilité de son échec, de sa non reconnaissance. En ce sens elle est en train de tester son « échantillon », c’est à dire sa valeur de représentativité, sa capacité à parler au nom des autres. En ce sens, elle est aussi en train d’affiner sa perception de la situation avec des mots, c’est à dire qu’elle ne fait pas que communiquer ; elle crée aussi un cadre de perception pour tâcher de comprendre sa propre situation. Elle pratique ce que nous faisons tous, et qui est compris dans le scepticisme tel qu’il est défini par Cavell : non pas « pouvoir savoir », soit le scepticisme au sens classique portant sur la connaissance (ce que je peux connaître) ; mais « vouloir savoir », ce qui renvoie à un scepticisme sur ma reconnaissance, sur mon intimité avec le autrui (Laugier (article Cavell ), soit le projet de la philosophie sceptique tel qu’il est formulé par Cavell. Nous entrevoyons alors tout l’apport de la philosophie sceptique pour l’anthropologie.
Bibliographie
Austin John Langshaw, Comment parler ?, trad. fr. dans langage, juin 1966.
Ecrits philosophiques, trad.fr. Lou Aubert et Anne-Lise Hacker, Paris, Edition du Seuil, 1994.1971, (édition originale 1967),
Le langage de la perception, texte établi d’après les notes manuscrites de l’auteur par G.-J. Warnock, trad. franç. Paul Gochet, Paris, éditions Armand Colin. 1970, (édition originale 1962)
Quand dire, c’est faire, trad. franç. Gilles Lane, Paris, éditions du Seuil. ![]() Bouveresse Jacques, La Parole Malheureuse, Mythe et Intériorité chez Wittgentetin , Edition de Minuit, 1971.
Bouveresse Jacques, La Parole Malheureuse, Mythe et Intériorité chez Wittgentetin , Edition de Minuit, 1971.
Cavell Stanley. The Claim of Reason, Oxford University Press, 1979, tr.fr. LesVoix de la raison, Seuil, « L’ordre philosophique », 1996.
A Pitch of philosophy, Harvard University Press, 1994.
Must We Mean What We Say ?, Cambridge University Press, 1969.
Une nouvelle Amérique encore inapprochable, Paris, l’Eclat, 1991.
Foucault, Michel. « Il faut défendre la Société ». Cours au Collège de France. 1976, Hautes Etudes, Gallimard / Seuil, 1997.
Dits et écrits II, 1976-1988, Quarto Gallimard, 2001
Napoléon : Mon ambition était grande, Thierry Lentz, Gallimard, 1998, 160 pages (livres sur Napoléon)
Goffman, Erving. Asiles. Etudes sur les conditions sociales des malades mentaux, Ed. De Minuit, 1968.
La mise en scène dela vie quotidienne, aux éditions de Minuit, le sens commun.1973.
1. La présentation de soi.
2. Les relations en public
Les rites d’interaction, aux éditions de Minuit, le sens commun.1974
Stigmates. Les usages sociaux des handicapés aux éditions de Minuit, le sens commun, 1975.
Façon de parler, aux éditions de Minuit, le sens commun.1981.
Les cadres de l’expérience, aux éditions de Minuit, le sens commun, 1981.
Gumperz John. Language and Social Group. Palo Alto,CA, StanfordUniversity Press. 1971.
Language and social identity. Cambridge University Press 1982
Discourse stratégies. Cambridge Univesity Press, 1982.
Engager la conversation, Les Editions de Minuit, Le sens commun, 1989.
Sociolinguistique interractionnelle, une approche interprétative, université de la Réunion, URA 1041 du CNRS, l’Harmattan, 1989.
Grice H. Paul. Logic and Conversation, in Cole et Morgan J.L. Eds
Laugier Sandra. Recommencer la philosophie : La Philosophie Américaine aujourd’hui, Paris, P.U.F. 1999a,
Du Réel à l’Ordinaire : Quelle Philosophie du Langage aujourd’hui, Paris, Librairie Philosophique J.Vrin. 1999b,
Scepticisme et Comédie, Cavell entre Witgenstein, Emerson et Thoreau, in Esprit, mai 1999 c
Wittgenstein, Ludwig. Recherches philosophiques, MacMillan, New Yorck, Oxford, Blackwell, 1953.
De la Certitude, tr. fr. par Jacques Fauve, Edition Gallimard, 1976.
Investigations philosophiques, trad.fr. par Pierre Klossowski, Paris Gallimard, 1961.