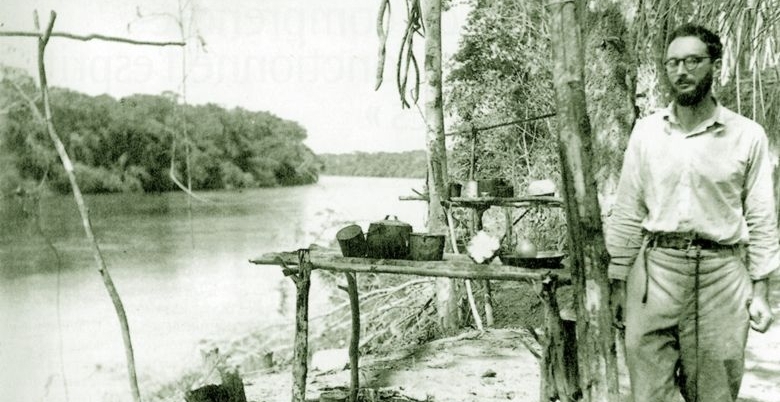“Les sciences sociales, cela sert aussi à faire la société.” J’ai pris cette phrase citée par Didier Fassin parce qu’elle m’a servi de point de départ pour le premier terrain que j’ai entrepris dans les années 1980s sur le mouvement alternatif à Berlin-Ouest. Cette phrase peut se comprendre de trois manières différentes et complémentaires :
1. À travers les sciences sociales comme connaissance le/la chercheur/e cherche en tant qu’expert ou savant à avoir un impact plus ou moins direct sur la société, une influence sur les orientations politiques et la direction de la transformation sociale.
2. Les sciences sociales servent à construire des catégories avec lesquelles la société se comprend elle-même. Elles participent donc à la construction des cadres cognitifs, des idéologies et des croyances.
3. Les sciences sociales servent aussi à déconstruire les catégories et les vérités sur lesquelles se basent les rapports sociaux et les rapports de pouvoir en particulier et offrent ainsi la possibilité de penser la société autrement.
Dans les années 1980s j’ai fait un retour de l’Afrique dans ma propre société, comme tant d'autres anthropologues (voir : La fin de l’exotisme ). En tant que anthropologue dans des collectifs de production à Berlin-Ouest j’ai voulu participer au mouvement alternatif qui était en plein essor à cette époque. Le mouvement était construit sur une culture de débat et de controverse. Les membres des collectifs se voyaient simultanément comme les expérimentateurs et les sujets d’experimentations sociales qui voulaient apporter des changements profonds de société. Cependant leurs façons de participer et de s’observer se distinguaient de la manière de voir de l’anthropologue par le fait que les membres des collectifs avaient des intérêts matériels et immédiats, par exemple le niveau de salaire, le temps de travail que l’anthropologue ne partageait pas. La participation de l’anthropologue au travail du collectif et à son autoréflexion relevait d’une autre nécessité. Mon regard d’observateur extérieur et mon analyse des rapports observés avait donc l’effet de projeter une image aux membres des collectifs avec laquelle ils étaient en accord ou désaccord selon leur position dans la situation de conflit observée, dans laquelle ne se reconnaissaient pas forcément ou pire, qu’ils trouvaient trop évidente pour être intéressante.
En 1991 quand mon livre sur les mouvements alternatifs à Berlin-Ouest fut enfin publié, le mur de Berlin était tombé, les mouvements alternatifs avaient pris fin et j’étais devenu le chroniqueur d’une époque, d’un mouvement, qui semble très loin par ses ambitions et ses façons d’apprécier la société, des préoccupations actuelles. L’impact que j’ai pu avoir sur la direction qu’a pris la transformation du mouvement alternatif me semble minime. Les catégories que j’ai construites pour faire sens des rapports sociaux observées n’avaient plus aucune importance pour les acteurs. Mes efforts à déconstruire les visions du monde et rapports de pouvoirs au sein des collectifs recevaient au mieux un intérêt poli parmi les ex-membres de collectifs qui avaient pris la peine de lire le livre. Le livre qui est né de mon engagement, la forme et le contenu relèvent de cet engagement, mais il mène maintenant une vie indépendante de mes premières intentions.